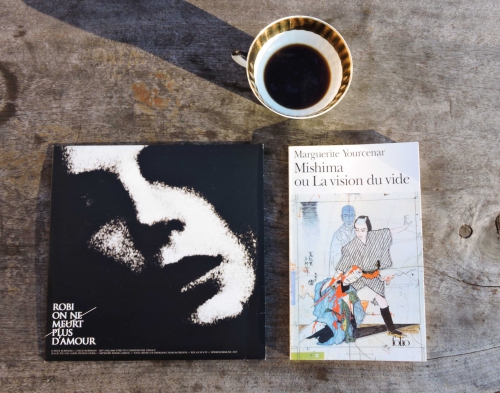"Mon intérêt pour la musique a toujours été très personnel et très obsédant. Je ne pense pas apporter le bonheur à l’humanité. J’écris juste une pièce musicale et je la joue."
- Philip Glass
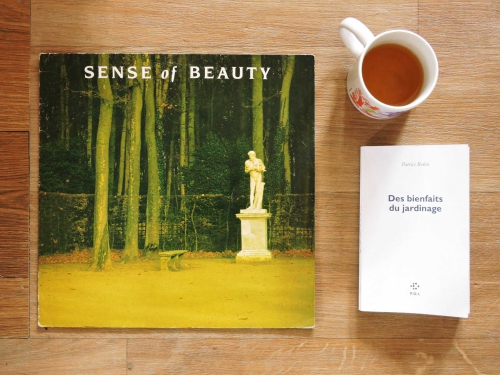
Je ne me souviens pas exactement quand j'ai découvert Philip Glass, probablement en même temps que Wim Mertens et Michael Nyman, qui sont autant de musiciens que j'associe avant tout avec le cinéma, la musique de Glass, le titre Opening en particulier, résonnant en moi avec le film Le Pornographe (de Bertrand Bonello).
Je me souviens bien de cet épisode de South Park qui se moque (gentiment) de Philip Glass.
Je me souviens aussi que c'est le titre Opening, figurant sur cette vieille compilation du label norvégien Unitron, qui a été le déclencheur de son achat, quoique j'aie aussi bien apprécié la pochette ainsi que la citation de Keats qui se trouve à son dos (A thing of beauty is a joy forever), ainsi que la présence de Brian Eno & Harold Budd, Durutti Column et Japan et plein d'inconnus qui le resteront, pour une compilation ambiante et mélancolique avec parfois des passages synthétiques assez vintage et presque désuets, comme si on croisait de la new wave avec du Satie, car oui : on est bien en 1985 ...
https://www.youtube.com/watch?v=P7NUz5ivqYg
En 2014, Patrice Robin hésite à accepter une résidence d'écriture dans un hôpital psychiatrique, car sa mère vient de sombrer dans la démence. Il accepte pourtant et note ses allers-retours entre le potager où l'on tente d'occuper les malades et l'hôpital spécialisé où se trouve sa mère qui ne le reconnaît plus. Le ton est humble, sobre, l'écriture est ce que l'on désigne par "blanche", sans fioriture, elle va à l'essentiel, se tient à proximité, mais ni trop près, ni trop loin non plus. On peut éventuellement reprocher l'aspect presque journalistique et finalement pas assez littéraire de ce livre, qui se complait dans une certaine observation sans prendre part, tel un documentaire sans voix off ; reste toutefois une expérience d'une rare intensité émotionnelle pour un auteur qu'on sent perdu des deux côtés de sa vie dont il essaie de retrouver, tant bien que mal, le centre. Pour les néophytes de l'œuvre de Patrice Robin je conseillerais plutôt l'excellent Une place au milieu du monde, paru il y a deux ans et qui se penchait, par le biais de la fiction, sur les ateliers d'écriture ; Des bienfaits du jardinage rappelle néanmoins, et en cela c'est un livre important, que l'écrivain, dans sa survie - survie qui consiste à accepter les animations culturelles, les ateliers d'écritures et les résidences qu'on lui propose -, que l'écrivain donc est constamment ramené à la réalité et que la condition même de la création de fiction, celle-là même qui pourrait être une promesse de liberté totale, eh bien cette liberté est assujettie à l'aspect économique de cette profession bien particulière. Patrice Robin est un exemple parmi tant d'autres, et son nouveau livre l'aboutissement de cette étrange vie qu'est celle de l'écrivain, obligé ici de passer dans une autre réalité, celle de personnes internées en hôpital psychiatrique, toutes différentes, et c'est bien cette multitude étrange qui fait office de jardin sauvage et constitue l'attrait majeur du livre de Patrice Robin.
Extrait de Des bienfaits du jardinage, de Patrice Robin (publié chez POL) :
"Je prends souvent un café dans un bar voisin de l'hôpital de jour en attendant l'heure de la séance. Parmi les consommateurs, quelques patients, un buveur de bière au matin, en bonnet de laine, anorak d'hiver, bermuda et baskets sans chaussettes. Il se balance d'un côté sur l'autre, me sourit. Un autre jour, une femme discutant fort avec son compagnon, et moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, avec tout ce qu'il y a à payer, le gaz, l'électricité... Ce jour-là, un homme, que je ne connais pas cette fois, s'arrête près de la table où je suis assis, se penche vers moi et me demande s'il a des paupières, si je les vois. Désarçonné, je garde le silence. Il fait de la dysmorphobie, dit-il, ne perçoit pas des parties de son corps parfois. Il a rendez-vous chez son psychiatre, va le lui demander. Je l'approuve. Je le revois la semaine suivante, il me pose la même question. Moins surpris cette fois, je regarde attentivement son visage et le rassure. Il sort de chez son psychiatre qui lui a donné la même réponse. Il dit trois fois qu'on lui fait beaucoup de bien en disant cela, qu'il est content de m'avoir rencontré.
La femme aux cigarettes, me voyant un matin penché au-dessus du parterre où sont plantés les thyms dont j'ai entrepris d'établir la liste comme je l'ai fait pour les pélargoniums et menthes, me propose spontanément de m'en dicter les noms. Nous passons une dizaine de minutes ainsi, elle parle, je note, Thym Capitatus, Thym Atticus, Thym Doré, Camphré, Serpolet, Résineux, Hirsute, Laineux, Foxley, Golden King... Puis elle s'interrompt et s'en va aussi brusquement qu'elle était venue.Un jeune homme vient me saluer au début d'une séance puis s'éloigne. Lors de la suivante, il me confie qu'il a été rédacteur en chef du journal de son lycée, m'a apporté un article qu'il veut me faire lire. Il y traite du 11 septembre 2001, date de la séparation de ses parents, précise-t-il. À peine ai-je terminé qu'il me donne deux autres textes de quelques pages. Les roses qui éclosent, les roses qui implosent. Je les lis également. Il tente, dans le premier, de raconter sa vie d'avant sa dépression et, dans le second, sa vie d'après, y parle à nouveau du divorce de ses parents et du 11 septembre, de la guerre en Afghanistan, de la présence de Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, met la grande histoire et la sienne sur le même plan. Son écriture est alerte, je lui dis."