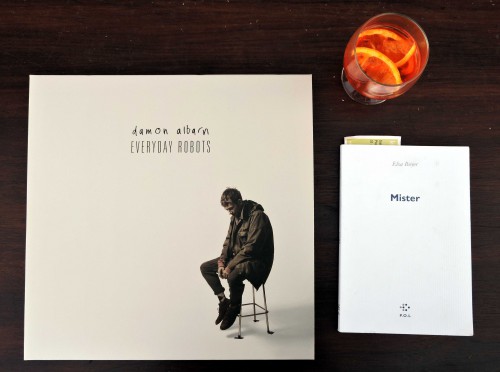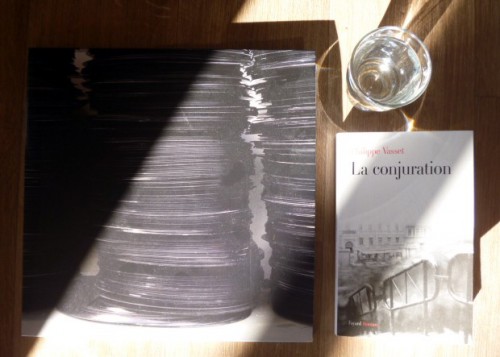"On n’est vieux que le jour où l’on cesse de désirer."
- Henry de Montherlant, La Mort qui fait le trottoir (Don Juan) (1956)

Je me souviens qu'écoutant une émission radiophonique avec comme invitée la chanteuse Françoiz Breut, celle-ci expliqua à quel point Frànçois Marry, alias Frànçois & The Atlas Mountains - avait apporté une touche électronique dans la production de son dernier (et joli) album (La chirurgie des sentiments) où se trouve une chanson d'elle que j'adore intitulée "Bxl bleuette", parce que j'aime Bruxelles et que, sans doute, cela me rappelle qu'à chaque fois que je m'y rends, je descends à l'hôtel des Bluets, près du Parvis de Saint-Gilles.
Je me souviens bien d'avoir été d'abord littéralement conquis par le magnifique duo "Cherchant des ponts" entre Françoiz et Frànçois, puis d'avoir désiré cet album de Frànçois and the Atlas Mountains, et d'avoir décidé de l'acheter et de l'avoir bien apprécié, avec son titre-palindrome - E Volo Love - qui m'a fait penser à celui, très beau, de Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni (Nous tournons en rond dans la nuit et nous serons dévorés par le feu) ainsi que l'impressionant Grand Palindrome de Perec, écrit en 1969, et composé de 1247 mots !!!
Je me souviens aussi d'avoir été passablement épaté qu'un groupe français se retrouve sur le label anglais Domino - Will Oldham, Anna Calvi ou encore le géant Elliott Smith ! -, place d'honneur qui s'explique bien à l'écoute de ce dernier album - Piano ombre - , qui possède une vraie originalité pop, de finesse dans les compositions, de caractère - parfois enfantin, faussement innocent -, de travail accompli - et bien accompli -, où j'y entends à la fois Talking Heads et Radiohead, et puis ce suave "La fille aux cheveux de soie" qui est la chanson qui m'obsède le plus actuellement :
Quand la fille aux cheveux de soie
Me demande ce que je veux boire
Je laisse couler
J'aime voir tout se renverserVouloir sentir son corps
Encore
Si resserré
On connaît Maupassant pour Le Horla, évidemment, et on retrouve d'ailleurs l'ambiance de ce fameux texte dans l'une des trois nouvelles intitulée La peur, qui paraît dans ce petit recueil que vient de publier l'éditeur La Part Commune dans sa sympathique collection La Petite Part. Mais c'est surtout Les caresses qui a attiré mon attention. Petite nouvelle composée de deux lettres, la première d'une dénommée Geneviève, la seconde d'Henri, "écrites sur du papier japonais en paille de riz", comme le précise le narrateur, et retrouvées "dans un petit portefeuille en cuir de Russie, sous un prie-Dieu de la Madeleine, hier dimanche, après la messe d'une heure", détail qui a toute son importance et clôt en beauté cet échange qui a pour objet l'amour et le désir comme le démontrent bien ces deux magnifiques passages qui appellent à l'abandon total, l'écriture de Maupassant devenant musique, et même symphonie :
"Certes, c'est là un piège, le piège immonde, dites-vous ? Qu'importe, je le sais, j'y tombe, et je l'aime. La Nature nous donne la caresse pour nous cacher sa ruse, pour nous forcer malgré nous à éterniser les générations. Eh bien ! volons-lui la caresse, faisons-la nôtre, raffinons-la, changeons-la, idéalisons-la, si vous voulez. Trompons, à notre tour, la Nature, cette trompeuse. Faisons plus qu'elle n'a voulu, plus qu'elle n'a pu ou osé nous apprendre. Que la caresse soit comme une matière précieuse sortie brute de la terre, prenons-la et travaillons-la et perfectionnons-la, sans souci des desseins premiers, de la volonté dissimulée de ce que vous appelez Dieu. Et comme c'est la pensée qui poétise tout, poétisons-la, Madame, jusque dans ses brutalités terribles, dans ses plus impures combinaisons, jusque dans ses plus monstrueuses inventions.
Aimons la caresse savoureuse comme le vin qui grise, comme le fruit mûr qui parfume la bouche, comme tout ce qui pénètre notre corps de bonheur. Aimons la chair parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blanche et ferme, et ronde et douce, et délicieuse sous la lèvre et sous les mains.
Quand les artistes ont cherché la forme la plus rare et la plus pure pour les coupes où l'art devait boire l'ivresse, ils ont choisi la courbe des seins, dont la fleur ressemble à celle des roses.
...
Supprimons, si vous voulez, l'utilité et ne gardons que l'agrément. Aurait-il cette forme adorable qui appelle irrésistiblement la caresse s'il n'était destiné qu'à nourrir les enfants ?
Oui, Madame, laissons les moralistes nous prêcher leur pudeur, et les médecins la prudence ; laissons les poètes, ces trompeurs toujours trompés eux-mêmes, chanter l'union chaste des âmes et le bonheur immatériel ; laissons les femmes laides à leurs devoirs et les hommes raisonnables à leurs besognes inutiles ; laissons les doctrinaires à leurs doctrines, les prêtres à leurs commandements, et nous, aimons avant tout la caresse qui grise, affole, énerve, épuise, ranime, est plus douce que les parfums, plus légère que la brise, plus aiguë que les blessures, rapide et dévorante, qui fait prier, qui fait commettre tous les crimes et tous les actes de courage ! Aimons-la, non pas tranquille, normale, légale ; mais violente, furieuse, immodérée ! Recherchons-la comme on recherche l'or et le diamant, car elle vaut plus, étant inestimable et passagère ! Poursuivons-la sans cesse, mourons pour elle et par elle.
Et si vous voulez, Madame, que je vous dise une vérité que vous ne trouverez, je crois, en aucun livre, les seules femmes heureuses sur cette terre sont celles à qui nulle caresse ne manque. Elles vivent, celles-là, sans souci, sans pensées torturantes, sans autre désir que celui du baiser prochain qui sera délicieux et apaisant comme le dernier baiser."