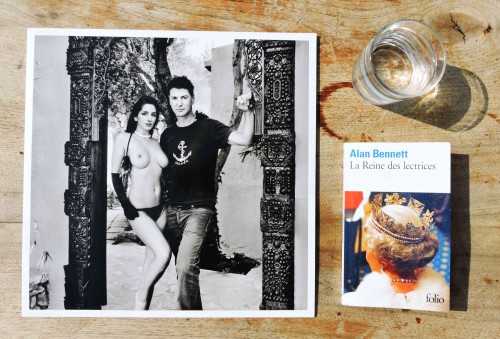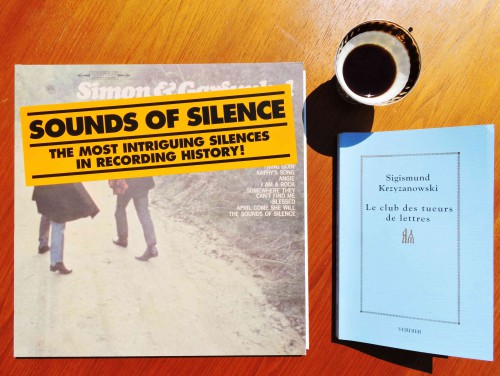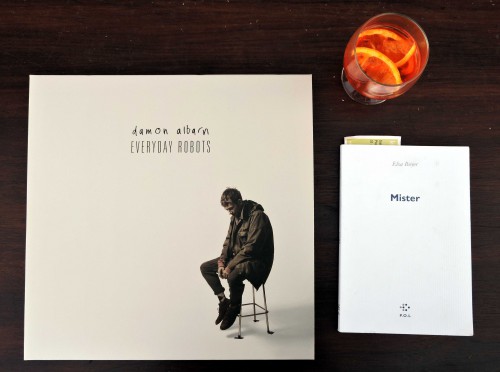"Pour être poète, il faut avoir du temps : bien des heures de solitude, seul moyen pour que quelque chose se forme, vice, liberté, pour donner style au chaos."
- Pasolini, La religion de mon temps (1958)

Je me souviens d'avoir découvert la voix magique de Gordon Sharp sur le titre Kangaroo qui se trouvait sur le premier album du projet This Mortal Coil.
Je me souviens avec beaucoup d'émotions de voir débarquer Gordon Sharp dans le magasin de disques où je travaillais, à Genève, en 1991, puis de l'avoir retrouvé avec plaisir en 2009 quand j'ai fait passer Cindytalk à l'Usine avec Blind Cave Salamander.
Je me souviens avoir souvent pensé qu'il y avait une forme d'injustice au fait qu'un groupe aussi curieux, avec une voix si merveilleuse et une attitude aussi radicale, n'ait jamais obtenu plus d'attention du public, puis, parallèlement, je suis satisfait que Cindytalk reste un secret bien gardé, surtout cet album (vibrant hommage à William Blake, Pasolini, Artaud et quelques autres solitaires), et particulièrement lorsque j'écoute ce lancinant A song of changes et ses paroles...
Dreamtime with some device
Measureless time in pain
Measureless time with shadow fall
Measureless time in soulWhat's will be in the last racing
Even my heart of everything
Everything that is
Il en est peut-être de même avec Linda Lê, grande voix de la littérature contemporaine, mais bien peu connue finalement. D'ailleurs qui se rappelle encore qu'elle fut dans le quatuor de finalistes au Goncourt 2012 avec Patrick Deville, Joël Dicker et Jérôme Ferrari ?
Ce livre métalittéraire paru en 2009 et qui résonne comme un hommage à son éditeur Christian Bourgois (décédé deux ans plus tôt), comporte de beaux portraits d'écrivains comme Robert Walser, Louis-René des Forêts, Thomas Landolfi, Osamu Dazai ou encore Stig Dagerman. Linda Lê ne mache pas ses mots, et je suis toujours épaté par son érudition, elle sait me conforter dans mes positions, tout en me secouant habilement.
Une certaine suspicion pèse sur ceux qui, en tricotant les mailles d'un ouvrage dit de fiction ou plutôt de friction, théâtre de luttes entre leurs différents moi - latents, hypothétiques, voire haïssables -, conservent une distance critique vis-à-vis de leur production. Ils ne vont pas jusqu'à la dénigrer, car ce ne serait qu'un piètre stratagème pour dissuader d'éventuels censeurs, sans être plus au clair avec eux-mêmes. Mais ils sèment de-ci et de-là des indices, propres à éclairer leur jeux, dans des textes qui ne fournissent aucune grille de lecture, ne sont ni des prédications ni des invites au ralliement.
La défiance qu'ils inspirent vient d'une erreur répandue : l'art n'empoigne que s'il obéit uniquement à l'instinct et fait litière de tout raisonnement. Méprise qui autorise les faux-monnayeurs en véracité à user et à abuser de cette recette : écrire avec ses tripes. Ce qui signifie chez ces gâte-sauce sans complexe, accomoder un salmigondis d'effusions calculées et d'effets ménagés, assez au goût du jour pour flatter le chaland, assez corsé pour allécher la commère qui somnole en chaque liseur. Les tics tiennent alors lieu d'éthique ; le chantage à l'empathie de précepte. Ces colporteurs d'une littérature-déversoir, tombereau d'éructations ou torrent de geignements, excipent d'un credo imparable : Avant moi le néant, après moi le déluge. De la subversion ils ont la livrée, et qu'on ne s'avise pas de leur dire : "Ô, mon roi ! Votre majesté est mal culotée !".
Le fait lyrique jaillit souvent d'une source violente, d'un flux de l'obscur où la convulsion, le spasme, l'hallucination, le "tétanos de l'âme", dirait Artaud, conspirent à provoquer des éclats d'écorché. Mais, quand bien même le transcripteur serait soucieux de restituer, dans chacune de ses phrases, l'écho de la vie qui résonne en nous, il doit se garder d'être le pantin de ses émotions, de confondre liberté et relâchement. Il lui appartient d'endiguer les crues verbales, de soumettre ses vocables à plusieurs contraintes.
René Daumal conseillait au scribe d'opérer une transmutation de l'accidentel, du subjectif, du mécanique, méthode radicale pour atteindre à l'essence de la Parole, c'est-à-dire la Saveur qui, selon les poètes hindous, possède trois vertus : la Suavité, ou fluidité, l'Ardeur, ou embrasement, l'Évidence, soit limpidité de l'eau et lumière du feu. C'est à travers cette alchimie qu'il réussit à convertir le chaos intime en une force d'attraction magnétique rassemblant des individualités aimantées par l'universel."