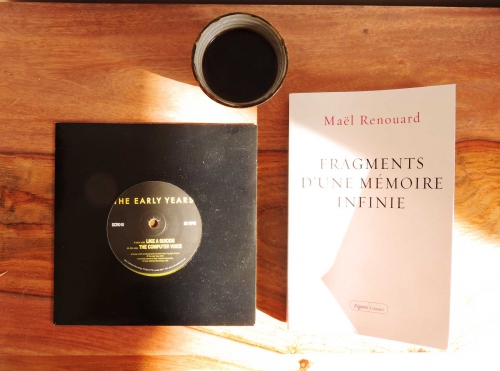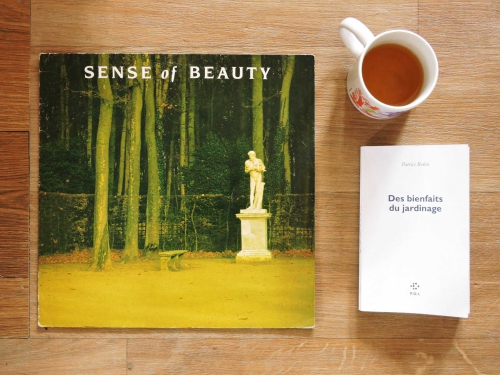"LA CATHEDRALE DE BRUME Un jour, l’architecte V., très connu en Belgique avant la première guerre mondiale, se lassa du béton et se mit à détester le granit. Il avait remarqué que la pierre, quoi qu’on fasse, ne livre rien. Têtue, elle n’accomplit que son destin qui est de durer. Elle concentre son immense force compacte sur le centre d’elle-même. Et elle oppose toute son inertie à ceux qui tentent de la distraire en la déplaçant et la taillant. Elle a horreur de l’élan que lui donne la flèche de l’église. Elle déteste tout ce qui est ailé. Elle souffre dans le vent. Et si on l’élève au fronton d’un temple, elle saisit toute occasion pour retourner à terre. C’est pourquoi les colonnes se couchent et les monuments qui semblent immuables s’enfoncent lentement dans le sol où la pierre retrouve les ténèbres aimées. L’architecte V. renonça à bâtir des maisons de pierre. Après des années de méditation, il construisit une cathédrale de brume. Le principe en était simple. Les murs et la tour étaient faits de brouillard au lieu de pierres. Le brouillard ne se laissant tailler ni cimenter, la construction fut difficile à réaliser. Mais l’architecte V. savait que le brouillard suit certains chemins de l’air comme l’eau suit le lit de la rivière. V. établit donc à l’aide de souffleries adroitement combinées, des courants d’air chauds qui s’élevaient comme des murs et des colonnes en creux. Ces murailles d’air chaud se rejoignaient en forme de voûte à trente-cinq mètres au-dessus du sol. La vapeur produite par une centrale cachée sous terre suivait les chemins d’air qui lui étaient ainsi tracés. L’architecte V. avait choisi un lieu superbe, une clairière dans la forêt d’Houthulst où les chênes et les hêtres s’élançaient plus haut encore que la voûte de l’église. Là, l’étrange monument se balançait doucement dans l’air immobile. L’architecture en était à la fois floue et précise car la vapeur, tout en ne s’écartant pas de son lit d’air chaud, était animée de courants ou plutôt d’une respiration. Le visiteur qui venait par le chemin forestier voyait soudain, au détour d’un vieux chêne, s’élever la masse de la cathédrale. Il s’arrêtait, étonné. Après avoir longuement contemplé le monument, sans trouver d’abord la cause de sa surprise, il se rendait compte soudain que l’église n’avait ni porte ni fenêtre. Il faisait alors deux ou trois fois le tour de l’église à la recherche de quelque entrée cachée. Il s’en allait déçu et inquiet car il soupçonnait un mystère auquel il n’était pas initié. D’autres trouvaient d’inspiration le « Sésame, ouvre-toi ». Ils entraient dans l’église en traversant les murs de brouillard.
La grande nef était admirable. Cent cinquante-quatre colonnes de brume coulaient lentement ver le haut et se rejoignaient en sept clefs de voûte. La vapeur s’y condensait en gouttes d’eau qui tombaient une à une au rythme du hasard. Elles étaient reçues au sol par d’admirables iris sculptés par l’orfèvre Wolfers. Les fleurs de ces iris d’un bleu profond étaient hérissées d’acier vibratile dont les lamelles s’émouvaient de sons ténus à chaque goutte. Cette musique, que selon la mode du temps tout le monde s’accordait à trouver violette, remplaçait les cloches que l’architecte V. n’avait pu accrocher dans la tour de brume. Mais le son au lieu de s’envoler dans l’espace comme le son des cloches n’était perçu que par l’oreille du visiteur et allait loin, très loin en lui. Et on avait l’impression que c’était la clochette d’un petit cheval qui tirait un traîneau dans la nuit que nous portons en nous, et qu’il glissait vers les plus lointaines frontières de nous-mêmes au-delà desquelles la musique meurt en une douce agonie. Ici et là, partout, en haut, de tous côtés, les branches des arbres qui entouraient la clairière traversaient les murs et la voûte de brume. Elles avaient l’air de tenir toute l’église suspendue entre ciel et terre. Cette impression était renforcée par le lierre qui, ne pouvant s’accrocher aux parois, recouvrait le sol d’un épais tapis don la couleur verte était exaltée par une lumière diffuse d’un gris exquis. Malgré la protection de la forêt, l’église se dispersait les jours de grande tempête. Elle ne se reformait qu’au crépuscule à l’heure où le vent tombe. C’était alors que l’on y priait le mieux, comme si quelque archange avait soufflé la tempête de ses ailes immenses en survolant la forêt ce jour-là et puis, le soir venu, s’était posé dans le chêne millénaire proche de la cathédrale. Mon père disait que dans cette église la prière était d’une haute ferveur parce quelle ne s’y formulait pas en mots. Debout sur le tapis de lierre, en entendant sans l’écouter la musique des iris, on était saisi par une sorte de ravissement muet. On devenait silence. Aucune voix même au plus profond de soi ne s’élevait. L’être entier se portait en un élan intense vers quelque chose, mais quoi ? Pas vers un but qui puisse se formuler, ni vers l’accomplissement d’un désir, ni vers un combat, ni vers une consolation. On se portait vers quelque chose dont on ignorait la nature. Vers tout. Vers rien. Et la joie qui répondait à cet élan n’avait pas de nom. En sortant ces soirs-là de l’église et en s’en allant par le sentier forestier, on n’aurait pu se confier à personne. On n’aurait même pu rien se dire à soi-même, car on ressentait une sorte de vide bienfaisant, comme si l’homme qui habite en nous, qui nous questionne et nous juge, était absent. Mon père me disait qu’il avait compris alors que les réponses aux questions ne sont jamais données par les explications mais par l’acceptation de la douleur et de l’angoisse.
Pour aller à la cathédrale de brume on prenait un sentier assez large où l’on marchait facilement à trios ou quatre de front. Mais pour le retour (et surtout après les prières, ou devrais-je dire: méditations?) on prenait un autre sentier plus étroit où l’on marchait seul parce que l’on avait besoin de silence et que de visiteur on était devenu pèlerin. Mon père a visité plusieurs fois la cathédrale de brume. Il m’a raconté qu’il y avait passé la veillée de Noël avec des amis en 1901. Ils avaient soigneusement préparé cette petite expédition. Pour laisser à la nuit son mystère ils avaient décidé de ne pas se munir de lanternes ni d’aucune autre lumière, renonçant même à la pipe et aux cigarettes estimant que la flamme des allumettes abîmerait l’obscurité. Se souvenant du petit poucet, ils avaient envoyé l’un d’eux pendant le jour baliser de cailloux blancs le sentier de la forêt. Ils se mirent en marche vers onze heures du soir pour arriver à minuit à l’église. Bottés et chaudement habillés, ils avaient l’impression de marcher dans une d ces immenses forêts du nord qui n’ont jamais livré leurs secrets. Tout autour d’eux le silence des bois d’Houthulst était impressionnant et était rompu seulement par le bruit de leurs pas sous lesquels se brisaient les feuilles mortes gelées avec des sons transparents comme si de minces plaques de verre volaient en éclats. Ils suivaient les cailloux blancs faiblement éclairs par les vagues reflets du ciel et qui avaient l’air de petites étoiles mourantes. Quand ils arrivèrent dans la clairière ils distinguèrent la masse obscure et comme ouatée de l’église, à la fois plus profonde et plus douce que la dure nuit de la forêt. Ils traversèrent les murs à tâtons. Aussitôt ils furent plongés dans l’obscurité totale. Le tapis de lierre souple sous leurs pieds dégageait un parfum amer. Ils surent qu’ils étaient dans la grande nef. L’un d’eux se cogna contre un iris dont la fleur vibratile fit entendre une plainte ténue qui était effrayante dans le silence et l’obscurité. Comme si à quelques pas d’eu, un être minuscule et charmant leur disait qu’il allait mourir. Ils se rendirent de tomber des clefs de voûte et que la musique des iris s’était tue. Alors aucun d’eux n’osa plus bouger. * Mon père me raconta qu’ils étaient restés immobile pendant des heures. Ils avaient l’impression que leur pensée même gelait. «Étrange, me dit-il, toutes les sensations s’ankylosent une à une et la respiration se fait toute petite comme si elle n’osait plus sortir de la poitrine. Nous avions la certitude qu’une sorte de miracle allait se produire. Peut-être allions-nous assister à notre propre mort, ou à quelque chose de plus simple et de plus merveilleux encore. Et c’est pour cela que nous restions tout à fait immobiles.
Nous avions la certitude qu’une sorte de miracle allait se produire. Peut-être allions-nous assister à notre propre mort, ou à quelque chose de plus simple et de plus merveilleux encore. Et c’est pour cela que nous restions tout à fait immobiles. Nous avions l’impression que si nous bougions nous bouleverserions les immenses mécanismes de l’Immobilité et du Silence où se préparait un événement extraordinaire. Cela te semblera incroyable, continuait mon père, mais nous sommes restés là sans bouger pendant près de sept heures. Et ce temps fut à la fois très long et très court. Soudain, au moment où le froid se faisait le plus intense, la voûte de la cathédrale s’ouvrit sur un ciel bleu, presque noir, où était accroché un croissant de lune et où brillaient cruellement des milliers d’étoiles.» Mon père se taisait à ce moment de son récit pour me laisser le temps d’imaginer le ciel, immense lac gelé, où es étoiles et la lune restaient prises dans une glace de jais. «Alors, continuait mon père, une chose étrange et merveilleuse s’accomplit dans la lenteur. La lenteur des aiguilles d’une montre. Après avoir dévoré la voûte de l’église, le froid s’attaqua aux murs et aux colonnes. L’église entière fut absorbée par la nuit et les conduites gelées cessèrent de souffler de la vapeur.» Quand le soleil se leva un peu après sept heures, mon père et ses amis poussèrent un cru d’admiration. Certains tombèrent à genoux, d’autres dansaient sur place comme des enfants, d’autres levaient la main, comme les personnages de certains tableaux romantiques qui, d’un geste, fixé pour l’éternité par le peintre. Désignent à notre attention un paysage de montage où glisse sans bouger le chaos d’un glacier. «Mais, disait mon père, ce que nous voyions n’était pas un chaos, c’était l’harmonie la plus parfait que j’aie vue de ma vie, véritable vision qui semblait être une sorte d’aboutissement de notre longue attente gelée. La cathédrale de brume s’était condensé en givre au millions de ramilles des hêtres et des chênes immenses qui entouraient la clairière. Elle étincelait au soleil, reconnaissable dans tous les détails de son architecture. J’avais l’impression que nous la voyions reflétée dans un de ces grands miroirs légendaires où l’hiver gèle à jamais ses plus beaux souvenirs. Certains de mes compagnons (ceux qui s’étaient défaite de ses murs, de ses colonnes et de ses voûtes, qu’elle avait abandonné aux arbres jusqu’à son image et qu’elle s’était jointe aux rois mages pour offrir à l’Enfant une église de rêve. Pendant que nous parlions non sans exaltation continuait mon père, le vent avait brusquement tourné à l’ouest, la température s’était adoucie, et la neige s’était mise à tomber à flacons serrés. En un quart d’heure, à innombrables petites touches et chutes silencieuses, la neige effaça de sa blancheur la blancheur de l’église de givre. Et les branches lentement fléchirent sous le poids immense des flocons légers. Le silence de la neige est différent de celui de la gelé. C’est un silence qui efface tout, même les formes, même les êtres humains. Le son de nos voix changea et ploya aussi sous tant de blancheur, pendant que les flocons s’amoncelaient sur nos vêtements et nos chapeaux.
Alors, sans nous concerter, nous sommes partis en empruntant le sentier des pèlerins don ton devinait encore le tracé grâce à une légère dépressions de la neige. Je me retournai une dernière fois vers la clairière. Déjà les flocons s’affairaient en une sorte de chuchotement silencieux à effacer nos pas, afin que personne ne puisse jamais en suivre les traces et retourner vers la clairière pour y chercher quelque vestige attestant l’événement extraordinaire auquel nous venions d’assister. D’ailleurs le givre et les traces de pas dans la neige appartiennent à l’Éphémère. Et on ne saurait jamais effacer assez vite les indices matériels d’un miracle qui n’appartient qu’à l’instant et dont la duré en peut se prolonger que dans la mémoire. Toute ma vie, disait mon père avec émotion, j’ai porté l’église de givre en moi et j’essaye de t’en transmettre l’image. Ne va jamais dans la forêt d’Houthulst. D’ailleurs elle a été presque entièrement détruite en 1918 lors d’une bataille meurtrière entre les armées belges et allemandes. On m’a dit que ses amis ont voulu rendre hommage à son génie. Ils ont eu l’idée saugrenue de lui élever un tombeau dans la forêt. Mais comme la forêt n’existe plus, ils ont dû se rabattre sur un petit bois de quelques hectares, dernier vestige des bois immenses qui faisaient euxmêmes partie il y a mille ans de la Fôret-Charbonnière. Et vois, concluait mon père, pour évoquer le souvenir de l’architecture V, pour rendre son nom indestructible, ils ont place sur le lourd tombeau une lourde pierre de granit, et l’épitaphe est gravée en lourdes lettres. On lit :
Ci-gît l’architecte V. Il construisit une cathédrale de brume
Nul doute, disait mon père sans dissimuler sa joie, que la tombe de granit que personne ne va plus saluer, s’enfonce lentement dans le sol où la Pierre retrouve les ténèbres aimées.» "