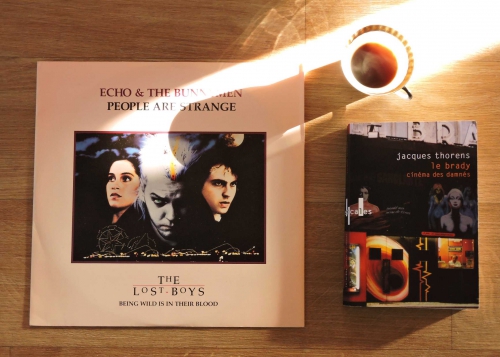"...là où la légèreté nous est donnée, la gravité ne manque pas."
- Maurice Blanchot

Je me souviens de mettre les pieds chez Sounds comme presque toutes les semaines, ça doit être l'été 1990, un bel après-midi d'ailleurs, il fait beau c'est sûr, et comme toujours j'ai l'impression de pénétrer dans une grotte où le disquaire se cache derrière un comptoir qui me paraît disproportionné par rapport à la taille du lieu, comptoir qui laisse à peine entrapercevoir la tête de Jean-Marie, et là - avant même de prononcer le salut habituel - je reconnais cette voix qui m'est chère, celle de Peter Murphy, mais la chanson m'est inconnue, c'est Cuts you up, et je me sens comme sur un bateau ivre - il me faut ce disque.
Je me souviens bien d'être allé voir un concert de Peter Murphy, cet ancien leader de Bauhaus, ce vrai dandy aux fausses poses de Bowie, c'était à la Salle du Faubourg, l'automne de la même année, mais d'avoir été un peu déçu - trop pop, trop propre peut-être ?
Je me souviens aussi qu'avec le temps j'ai délaissé l'album Deep pour ce maxi composé de deux versions de Cuts you up et sa mélodie aguicheuse dont je ne me suis jamais lassé ainsi qu'une version alternative de la très belle ballade A strange kind of love, qui reste à ce jour mon titre favori de Peter Murphy.
A strange kind of love
A strange kind of feeling
Swims through your eyes
And like the doors
To a wide vast dominion
They open to your prize
This is no terror ground
Or place for the rage
No broken hearts
White wash lies
Just a taste for the truth
Perfect taste choice and meaning
A look into your eyes
Blind to the gemstone alone
A smile from a frown circles round
Should he stay or should he go
Let him shout a rage so strong
A rage that knows no right or wrong
And take a little piece of you
There is no middle ground
Or that's how it seems
For us to walk or to take
Instead we tumble down
Either side left or right
To love or to hate
https://www.youtube.com/watch?v=y3Cy7B9x0qk
Si David Bosc déclare qu'il aime animer les choses anciennes, celles qu'on n'invente pas, à la faveur d'une brume de fiction - ce qu'il avait précédemment fait pour Claire Fontaine, son roman sur les dernières années de Courbet -, l'écrivain procède ici presque à l'inverse : il utilise un fait divers, un visage entraperçu dans le carnet d'un poète, pour inventer une chose nouvelle qui se déploie en toute liberté - cette chose est bien sûr ce beau roman dont le titre est tiré d'un poème de Mandelstam : Mourir et puis sauter sur son cheval. Pour ne pas gâcher une lecture qui a besoin autant d'attention que de virginité, il ne faudrait presque rien savoir de plus et ne plus rien dire ni écrire ; mais j'ajouterais quand même pour guider le curieux vers ce livre, que celui-ci m'évoque la Métamorphose de Kafka ainsi que, moins connu - malheureusement -, le magnifique Gorgô de Claude Louis-Combet ; animalité et sensualité ; appétit de vivre, frénésie de liberté, besoin d'art et d'amour jusqu'à ce que l'aventure tourne à la dévoration... Car ce livre possède à la fois la gravité de la bonne littérature et la légèreté qui lui permet de s'envoler vers les sommets. Voilà, il faut le lire, maintenant.
Extrait de Mourir et puis sauter sur son cheval, de David Bosc (publié aux éditions Verdier) :
"À l'aube, les arroseuses mouillent la poussière des rues ; elle reviendra avant midi cet empêchement de voir et de respirer que l'on croyait à demeure chez les porteurs de babouches et de sombrero. Poudre de briques, plâtre des murs et des plafonds ; on dit que trois cent mille bombes sont tombées sur la ville.
Un gamin d'une quinzaine d'années est assis dans la vitrine crevée d'un marchand de livres d'occasion. Le bâtiment menace ruine, il a perdu son toit et son dernier étage, les occupants ont été évacués. Dans son costume de laine, avec une cravate qui ressemble à la ceinture d'un vieux peignoir, le bonhomme est en pleine lecture. Il a le pied sur une pile bien ordonnée - son premier choix - tandis que tous les autres livres, au sol et jusque sur le trottoir, s'étalent, se chevauchent et font les écailles d'un dragon terrassé. Il y a là comme une sécession et la guerre s'en trouve repoussée à mille lieues, au diable.
- Dis, c'est un miroir ou un trou de serrure ?
- Hein ?
- Dans ton bouquin, tu regardes vivre les autres ou tu ne vois partout que toi ?"