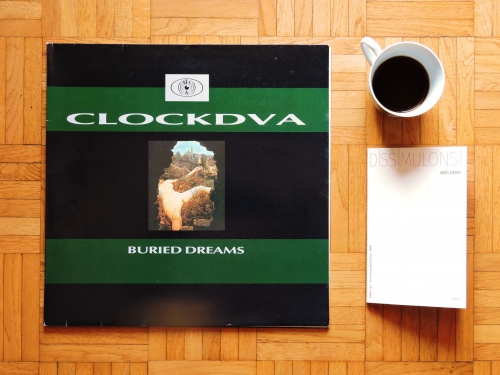"Tout le langage de l'esthétique est contenu dans un rejet, par principe, de ce qui est facile, compris dans tous les sens que l'éthique et l'esthétique bourgeoises donnent à ce mot."
- Pierre Bourdieu, La Distinction

Je me souviens qu'après mon passage déçu à la librairie Lello & Irmão, à Porto, où l'on voit beaucoup de touristes mais où l'on a peu de chances de rencontrer de véritables lecteurs, la librairie étant devenue "l'une des plus belles du monde" et donc un aimant pour les vacanciers en goguette qui n'y achètent rien, ou, au mieux, une carte postale de Porto, j'avais eu cette chance formidable de tomber, Rua da Picaria 84, sur le magasin de disques bien caché MateriaPrima, où, après avoir écouté plusieurs galettes locales, j'avais fait l'acquisition de ce beau disque des portuans Evols, ce qui avait d'ailleurs fait la joie du disquaire puisqu'il s'agit, en fait, de son groupe !
Je me souviens bien d'avoir visité une quantité de villes en cherchant surtout leurs librairies et leurs disquaires, ce qui permet de modifier radicalement l'expérience urbaine, que cela soit en cherchant Radiation Records à Rome, dans le quartier de Pigneto (sur les conseils de Zoé - merci!), ce qui m'a fait ensuite découvrir le lieu de tournage d'un film de Pasolini, ou la librairie du poète Umberto Saba, à Trieste, où le seul livre que je voulais à tout prix était aussi le seul qui n'était pas à vendre, car dédicacé par l'auteur au libraire...
Je me souviens aussi que si Evols se place quelque part entre le lancinant Ocean, des Velvet Underground, et To here knows when, des My Bloody Valentine (avec un petit quelque chose, au fond du tableau, de New dawn fades - de Joy Division), le groupe se distingue aussi (et je dirais même : en plus de faire de la bonne musique) par cette pochette énigmatique ne comportant aucune information, avec, à l'intérieur, ces petites vignettes de personnes de dos, ce qui laisse l'auditeur libre de toute interprétation - décidément, tout me plaît chez Evols.
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7hqSpZpyM
Jorge Carrión est encore inconnu par chez nous, malgré la publication de nombreux romans en espagnol il a fallu cet essai pour qu'il soit traduit pour la première fois en français - mais quel essai ! D'une érudition noble, d'une curiosité sans limite, d'un flair certain et philosophe avec ça, l'auteur de ce fantastique récit de voyage pour découvrir les libraires du monde, celles de Porto, Berlin, Istanbul, Paris, Le Caire ou bien Athènes, donne à penser le livre et la littérature aujourd'hui. Il s'agit de réfléchir à leur place dans l'Histoire, dans le Temps et la Géographie, et comme il l'indique page 276 : "Ne nous y trompons pas : les librairies sont des centres culturels, des mythes, des espaces de communication, de débats, d'amitiés et même d'amourettes causées en partie par leurs attirails pseudo-romantiques, très souvent dirigés par des lecteurs artisans qui aiment leur travail, et même par des intellectuels, éditeurs et écrivains qui savent qu'ils font partie de l'histoire et de la culture, mais ce sont avant tout des commerces". C'est que l'auteur de ce passionnant livre ne tombe pas dans l'excès d'idéalisation du métier de libraire, bien qu'il dédie un chapitre aux librairies résistantes, et je parle ici de celles qui vendaient des livres interdits pendant les dictatures, et qui ont parfois chèrement payé cette prise de risque, ce qui n'est pas le cas des librairies sous nos latitudes qui ont choisi l'"engagement politique" comme image de marque - comme "marqueur" -, pour faire simplement plus de sous, le livre "alter-mondialiste" (utilise-t-on encore ce mot d'ailleurs?) étant une niche comme le sont la littérature enfantine ou l'ésotérisme, niches qui, d'ailleurs, voient leur chiffre d'affaire progresser d'année en année. Mais passons. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que son auteur donne à entendre et comprendre la mythologie de certaines librairies. Et qui dit librairies, dit aussi littérature, et donc écrivains. Ainsi on en croise abondamment : Bolano, Sebald, Benjamin, Sontag, etc. n'oublions pas que nombre d'entre eux affectionnent les librairies, lesquelles ont parfois joué un rôle très important dans leur vie, du moins dans leur carrière d'écrivain. Jane Bowles a ainsi rencontré sa meilleure amie dans une librairie de Tanger; James Boswell a fait la connaissance de Samuel Johnson dans un commerce de livres ; Cortázar découvrit Opium de Cocteau et son point de vue sur la littérature fut irrémédiablement changé, etc. La librairie est peut-être, encore, l'un des lieux où se joue la géopolitique culturelle d'un pays, ou d'une ville, du moins d'un quartier. C'est ce que ce livre envisage, et c'est pourquoi il est aussi important de le lire, évidemment, car loin d'être un objet de nostalgie puérile, c'est véritablement un geste de pensée mouvante.
Extrait de "Librairies - Itinéraires d'une passion", de Jorge Carrión (traduit de l'espagnol par Philippe Rabaté - édité au Seuil)
"L'art et le tourisme se ressemblent dans la nécessité que ce signal lumineux existe, à savoir ce qui attire le lecteur vers l'œuvre. Le David de Michel-Ange attirerait très peu l'attention s'il se trouvait au musée municipal d'Addis-Abeba et s'il s'agissait d'une œuvre anonyme. En 1981, après avoir publié avec beaucoup de succès Le Carnet d'or, Doris Lessing envoya à plusieurs maisons d'édition son nouveau roman sous un pseudonyme d'écrivain non publié, et il fut partout refusé. Dans le cas de la littérature, ce sont les maisons d'édition qui essaient en tout premier lieu de créer des marqueurs par le biais du texte de quatrième de couverture ou de l'article de presse : mais ensuite le critique, l'académie et les libraires créent les leurs, qui décideront du sort réservé au livre. Parfois ce sont les auteurs eux-mêmes qui le font, consciemment ou inconsciemment, formant un récit autour des conditions de production de leurs œuvres ou de leurs conditions de vie à cette époque-là. Le suicide, la pauvreté ou le contexte d'écriture sont le type d'éléments que l'on intègre souvent dans le marqueur. Ce récit, sa légende, est l'un des facteurs qui permettent la survivance du texte, sa persistance comme classique. La première partie du Quichotte, écrite, suppose-t-on, en prison et la seconde partie contre l'usurpation d'Avellaneda : la lecture du Journal de l'année de la peste comme si c'était un roman ; les procès contre Madame Bovary et Les Fleurs du mal ; la lecture radiophonique de La Guerre des mondes et la panique collective que provoqua la chronique de cette apocalypse ; Kafka sur son lit de mort ordonnant à Max Brod de brûler son œuvre ; les manuscrits de Malcolm Lowry qui brûlèrent et disparurent ; le scandale de Tropique du cancer, de Lolita, de Howl et du Pain nu. Le marqueur est parfois imprévisible et se construit longtemps après. Tel est le cas des romans rejetés par de nombreuses maisons d'édition comme Cent ans de solitude ou La Conjuration des imbéciles. Ce fait n'a bien sûr pas été utilisé comme argument de vente au moment où - finalement - l'on publia ces œuvres, mais lorsqu'elles obtinrent le succès, on le récupéra comme partie d'un récit mythique : celui de leur prédestination."