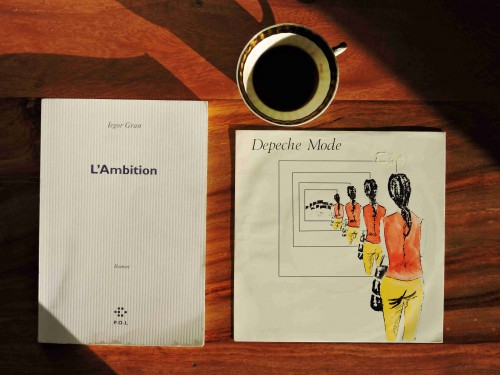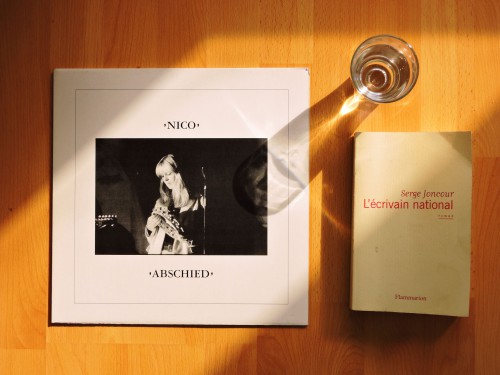"Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison?" - Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir (1968)

Je me souviens de cet automne 1988 où Nick Cave est venu jouer à Genève, de son nouvel album - Tender Prey - exposé sur une paroi du magasin Sounds, et puis du film de Wim Wenders - Les Ailes du désir -, où Nick joue son propre rôle, un chanteur possédé, l'archétype même du rocker maudit dans mes yeux d'adolescents.
Je me souviens bien qu'elle fut ma surprise d'entendre deux remarquables reprises de Mercy Seat, d'abord en 1997 par le groupe allemand Goethes Erben sous le titre Sitz der Gnade - surprenante parce qu'interprétée avec éloquence et conviction dans leur langue natale -, et puis, trois ans plus tard, la superbe version qu'en a donnée Johnny Cash, avec sa voix d'une profondeur incroyable... quel bel hommage à l'un des titres phares de Nick Cave, et mon favori de toute sa discographie.
Je me souviens aussi que mon fantasme le plus cher, et ce depuis plus de quinze ans, serait de tomber sur un DJ qui enchaînerait Haus der Luege d'Einstürzende Neubauten et The Mercy Seat de Nick Cave, deux titres hors norme datant presque de la même époque, tout aussi percutants l'un que l'autre, puissants musicalement, intelligents au niveau des textes, servis par des chanteurs charismatiques...
And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this weighing of the truth.
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die
En attendant de pouvoir lire le dernier livre d'Antoine Volodine - Terminus radieux, prêté à quelqu'un pour l'instant -, j'ai eu la bonne idée de me rabattre sur Écrivains, un recueil paru il y a quatre ans et qui donne la parole à un chœur tragique d'écrivains (fictionnels) post-exotiques (comme aime à les dénommer l'auteur), multiplicité d'une même expérience, celle de la prison, et portrait décalé et en pièces de Volodine lui-même. Là où la littérature contemporaine induit une inévitable normalisation de la transgression, celle de Volodine, et de ses Écrivains se porte vers la transcendance, le radicalement autre, la singularité vraie (et totale). On est loin des portraits d'écrivains alcooliques ou médiatiques, on a là des écrivains non pas maudits mais sans avenir. Le monde où ils évoluent est un monde en ruine, répressif, stalinien ou peut-être même post-apocalyptique, et où la seule certitude est l'échec final. Le monde de Volodine est perdu mais n'empêche pas d'inventer la rédemption tout en se sachant perdu. C'est un monde hérité de Kafka, Beckett et Tarkowski, et c'est une lecture aussi puissante que troublante...
"Un temps passe.
- Bien entendu, reprend-elle, notre parole ne prétend pas avoir une quelconque utilité dans le combat égalitariste concret qu'il conviendrait de mener, hors les murs, pour libérer des cycles du malheur les cinq ou six milliards d'individus qui y sont plongés. Ce que des actions militaires n'ont en aucune manière ébréché, des paroles d'écrivains ne peuvent le menacer ni le briser. Nous savons cela. Nous n'entretenons aucune illusion sur cela.
Elle ne bouge pas pendant un moment, puis elle se cogne le crâne, plusieurs fois, sur la paroi de ciment contre laquelle elle s'appuie.
- Nous n'éprouvons aucune fierté en maniant la parole, même si nous savons que notre poésie n'est pas comparable aux jongleries serviles que produisent en abondance les domestiques bavards des maîtres. Nous connaissons notre insignifiance. Dans un univers où la multiplication du verbe est le terreau sur quoi prospèrent les acteurs du malheur, sur cette ignoble scène de théâtre où le foisonnement des débats contradictoires est un écran cynique derrière quoi les maîtres conservent les mains libres, le verbe n'a ni influence ni force. Nous ne vivons plus dans cet univers, mais notre forteresse carcérale n'est pas non plus un lieu où dire les choses permette de changer les choses. La parole post_exotique s'interrompra lorsque le dernier de nos écrivains s'éteindra, et personne nulle part ne s'en rendre compte. Toutefois, tant que nous disposerons d'un peu de souffle encore, nous inventerons encore et encore la magie absurde de cette parole, nous irons dans les mots et nous dirons le monde.
Linda Woo est en lambeaux, le vent et la solitude l'ont déchirée encore une fois, elle est trempée de sueur et de larmes. Moi aussi.
- La leçon est terminée, dit-elle pour conclure."