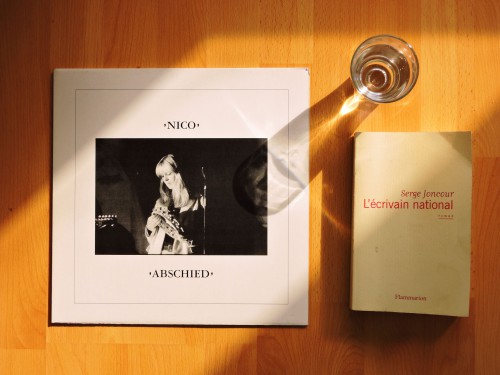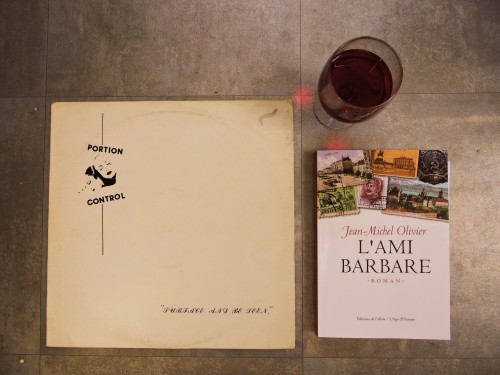"On ment plus qu'il ne faut - par manque de fantaisie : - la vérité aussi s'invente."
- Antonio Machado Y Ruiz

Je me souviens de m'être dit qu'avec une pochette aussi moche, il valait mieux acheter cet album dans son format compact-disc. J'ai bien fait.
Je me souviens bien qu'à l'écoute de ce Julian Plenty is... Skycraper, album solo sous pseudo du chanteur d'Interpol - groupe rock comparé plus à tort qu'à raison à Joy Division - j'ai eu la sensation de découvrir une compilation de face B de son groupe, mais que, malgré des titres par trop hétéroclites, l'artiste s'en sortait plutôt bien lorsqu'il donnait de l'espace, de l'air, plus de place aux silences, ceci notamment dans ses compositions les plus intimistes, qui, pour le coup, en deviennent plus convaincantes.
Je me souviens aussi d'avoir balayé d'un revers de main les chansons les plus pop pour ne garder que les plus cinématographiques, comme le sombre et lancinant Skycraper, le romantisme pathétique (mais supportable) de On the esplanade, et surtout l'intrigant quoique trop court Madrid song, avec sa ligne vocale répétitive et obsédante :
Come have at us, we are strong
Come have at us, we are strong
Come have at us, we are strong
Sans Carla Demièrre qui m'a fortement conseillé ce livre je serais sans doute passé à côté ; trop de sorties, trop de divertissements et trop de tentations nous font parfois rater l'essentiel, à savoir la bonne littérature contemporaine. Kiko Herrero, galeriste parisien, publie chez POL ce livre au titre ponctué à l'espagnole mais pourtant écrit en français. ¡ Sauve qui peut Madrid ! revient sur son enfance dans la capitale durant la période franquiste (et postfranquiste). Il réinvente la vérité sous forme de courts chapitres, avec une légère accélération à la fin du récit, surtout lorsqu'il évoque avec un certain désenchantement ses brefs retours à Madrid (l'auteur réside depuis une vingtaine d'années à Paris). Les passages sur l'enfance sont beaux et terribles à la fois. Herrero sait décrire à travers ces vignettes à peine altérées par le temps la vie dans l'Espagne de Franco. Il y a autant de légèreté que de gravité dans ces petites histoires, et si j'apprécie beaucoup les quelques passages sur l'après-franquisme, la movida, les années de drogue, de prostitution, de questionnement sexuel (et puis sa consommation effrénée quasi-obsessionnelle), tout ça se déroulant sur un fond de musique new wave ou rock alternatif pour peu qu'on ait un peu d'imagination (et de culture), c'est surtout les histoires d'enfance qui sont les plus marquantes et donnent tout son intérêt à ce livre. C'est en effet une brillante fiction biographique qui n'a rien d'une fresque (heureusement!) dont le regard ne pourrait épouser tous les détails et la superficie, mais qui se présente plutôt comme un album de photographies de famille, révélant un peu plus de ses secrets tourments au fil des pages qui craquellent lorsqu'on les tourne.
"Ma sœur Sibila a seize mois de plus que moi. Elle est brune et très grande. Elle a un oreiller qu'elle appelle Nonfaï, un cheval blanc de Camargue. Quand elle dort, elle le serre très fort entre ses cuisses : elle craint que son cheval ne s'échappe pendant son sommeil. Sibila achète des fascicules monographiques de peinture chez le bouquiniste du quartier. Elle copie des tableaux de Gauguin, Ensor et Utrillo. Elle a le sens du raccourci et de la synthèse. Elle est sensible aux doubles discours, aux jeux de mots, à la couleur des sons. Sibila comprend vite les situations et les fait tourner à son avantage. Elle désarçonne les adultes par sa franchise et reconnaît en un éclair leur hypocrisie. Quand nous arrivons à Navacerrada pour passer les vacances, ma sœur a six ans. Une voisine, Conchita, institutrice très catholique, femme d'un juge franquiste un peu fou, vient se présenter :
- Voulez-vous vous joindre à nous, dimanche, pour aller à la messe ? demande-t-elle à ma mère.
- Heu... Oui, peut-être... Avec le voyage, je ne sais pas si nous irons le matin ou le soir...
- Mais, maman ? pourquoi tu dis ça ? Nous sommes athées et communistes et nous n'allons jamais à l'église.
Ma soeur Sibila est comme ça. Sa sincérité est désarmante. À l'école, elle est la dernière de la classe. Elle s'en fait une fierté et m'explique qu'être le dernier c'est être le premier mais à l'envers. Sibila n'a qu'une amie qu'on appelle la Girafe. C'est la fille d'un torero et d'une actrice italienne et les enfants se moquent de sa taille et de son long cou. Sibila rêve toutes les nuits de cascades de lentilles qui finissent par l'enterrer. Elle a des visions que nul autre ne perçoit. Elle vit dans un monde imaginaire et souvent des fantômes la hantent.
Quand mes parents invitent des amis, mon père fait monter Sibila sur la table du salon et lui fait réciter " À un orme sec " d'Antonio Machado. Ce poème raconte l'histoire d'un arbre mort au bord du Douro. La mousse jaunâtre de cet orme, son écorce blanche et sale, son tronc vermoulu me rendent triste. J'ai toujours su que Sibila était cet arbre fendu par la foudre. J'ai toujours espéré qu'avec les pluies d'avril et le soleil de mai quelques feuilles vertes bourgeonneraient."